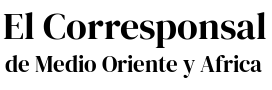Taliban un jour, taliban toujours
À Kandahar, leur ancien bastion, les talibans sont partout. Repentis ou non, rasés ou pas. Et certains rêvent encore d’un nouveau djihad contre les Américains.
Par Luc Chartrand
On croyait les talibans arrêtés, exilés ou cachés dans des grottes. Pourtant, nous venions à peine d’arriver à Kandahar, en Afghanistan, que Nangialai, un jeune taliban de 25 ans, nous servait le thé!
Dans cette ville que l’on disait être leur fief, les talibans sont encore partout. Certains conduisent des taxis ou cherchent du travail. D’autres ont été intégrés dans l’armée du nouveau gouvernement afghan ou dans la milice du nouveau gouverneur local. À peine leur défaite avait-elle été confirmée qu’un peu partout dans le pays des milliers de combattants changeaient de maître. Nangialai était du nombre.
“À la chute de Kandahar, mes amis m’ont demandé de les rejoindre dans l’armée du nouveau gouverneur. Au début, j’ai refusé; mais ils ont insisté et, comme nous étions amis, je me suis dit que c’était une occasion de les retrouver.”
Entre le gouvernement central, à Kaboul, et les provinces, où les talibans étaient bien implantés, il y a encore des disputes à propos de la place que ceux-ci devraient occuper dans le nouveau régime. “Il y en a beaucoup qui sont des démocrates ou des personnalités nationales, dit le gouverneur de Kandahar, Gul Agha. Ce ne sont pas tous des terroristes.”
Il y a six ans, Nangialai s’était porté volontaire pour se battre avec les talibans. Au moment de la défaite des siens, il commandait 25 hommes. En se ralliant à Gul Agha, il a pu conserver son travail, de même que ses biens les plus précieux: un pistolet, un fusil d’assaut et une mitrailleuse… Cet hiver, on l’a assigné à la protection des journalistes de Radio-Canada!
Nangialai n’a rien renié…
“Les talibans étaient bons. Ils ont servi le pays. Tout était interdit, comme le haschisch. La sécurité était assurée. Depuis leur départ, les choses se dégradent. Hier soir, des grenades ont été lancées contre l’hôpital. Il n’y a plus de sécurité.”
Il est difficile d’imaginer que Kandahar, un gros bourg provincial qui fait à peine la superficie de Saint-Hyacinthe -mais qui, avec ses 250.000 habitants, est considéré comme la deuxième ville de l’Afghanistan-, a été l’épicentre d’une crise mondiale.
En réalité, le monde aurait fait peu de cas des talibans s’ils n’avaient donné l’asile à Oussama ben Laden et aux membres du réseau Al-Qaeda. Ceux-ci n’ont d’ailleurs pas laissé beaucoup de souvenirs dans les esprits à Kandahar. La plupart vivaient à l’extérieur et venaient très peu en ville.
Nangialai, qui ne sait pas lire, pense qu’Oussama ben Laden n’a rien à voir avec les attentats du World Trade Center et que ce sont les Américains eux-mêmes qui ont orchestré cette hécatombe, se donnant ainsi un prétexte pour envahir son pays.
On exagère beaucoup l’importance “stratégique” de l’Afghanistan. C’est en fait son manque d’intérêt propre qui pose problème: pas de richesses naturelles, aucun débouché sur la mer… les fruits de sa conquête ne valent tout simplement pas l’investissement. Résultat, le pays est toujours resté un lieu de passage, chroniquement instable, aux mains de tribus montagnardes insoumises qui pratiquent la vendetta et acceptent parfois de se battre au profit d’un voisin qui paie bien.
Avec l’armée américaine -et les Forces canadiennes- qui campe à la sortie de la ville, il est peu probable que Kandahar redevienne le fief de l’islamisme international. Mais pour la libéralisation, il faudra patienter…
Si la télévision nous a montré des Afghanes qui se dévoilaient publiquement lors de la prise de Kaboul par les troupes de l’Alliance du Nord, le 13 novembre dernier, c’est en vain qu’aujourd’hui on en cherche une seule ayant le visage découvert dans les rues de Kandahar. Pour l’essentiel de la journée, la rue appartient aux hommes. Les femmes ne sortent qu’à certaines heures, lorsqu’elles ne sont pas occupées aux tâches domestiques. Et, même couvertes de la tête aux pieds, elles se détournent au passage des étrangers.
À la différence de Kaboul, la capitale instruite et relativement occidentalisée, Kandahar est restée conservatrice, pure et dure… “Arriérée!” tranche, moins diplomatiquement, Lailoma Daoud Barak, une jeune femme aussi émancipée qu’on peut l’être ici à 20 ans et qui, pourtant, jamais ne sortirait sans sa burqa!
Le sud de l’Afghanistan, pays des Pachtounes, où se trouve Kandahar, obéit à un islam primitif, qui a peu évolué depuis des siècles, et le port de la burqa a plus à voir avec la tradition qu’avec les décrets des talibans. “On ne peut pas obtenir la libération si soudainement, dit Lailoma Daoud Barak. Si nos aînées décidaient d’enlever leurs burqas, alors nous le ferions aussi.”
Dans le salon de sa famille, un magnétoscope repasse pour la nième fois un film de James Bond avec des filles aux décolletés sulfureux. Même sous l’ancien régime, une certaine licence a toujours prévalu derrière les murs. Comme dans bien des maisons, chez les Daoud Barak on regardait des vidéos (il n’y avait aucune émission locale et les antennes étaient trop apparentes) en cachette dans la cave pendant que la mère surveillait, à l’étage, pour donner l’alerte en cas de visite de la police religieuse -qui n’est jamais venue, précise-t-on.
Les talibans ont laissé derrière eux une cité presque médiévale, où les signes de la modernité se limitent aux véhicules motorisés et aux kalachnikovs. Quelques mois après la chute du régime, on peut encore décrire Kandahar en énumérant ce qu’on n’y trouve pas: un journal, des feux de circulation, des arbres, un bureau de tourisme, des numéros de porte, des cols bleus, des banques, des trottoirs, des bars, des lunettes…
Un jour, j’aperçois dans la rue un homme qui porte des lunettes (le premier!). Je m’approche… Il connaît l’anglais et nous commençons à discuter. Mais ma présence a un effet magnétique sur la foule. Au bout de deux minutes, 50 hommes sont massés autour de nous et tous veulent parler en même temps. Certains tirent sur mon t-shirt, d’autres viennent par derrière pour me toucher ou me pousser légèrement dans le dos et se sauvent en riant, tandis qu’un type donne des coups sur mon portefeuille dans la poche arrière de mon jean. Il est devenu impossible de s’entendre parler. Et comme ce bain de foule est en train de prendre une tournure inquiétante, je décide de m’éloigner.
Par sa seule présence, une collègue fait un véritable malheur. La vue d’une Occidentale, même sobrement vêtue, les cheveux couverts d’un châle, crée une commotion. C’est jour de fête et beaucoup de gens ont leur appareil photo. Quand elle entreprend de traverser la grande place du rond-point, au centre de la ville, des dizaines de photographes amateurs se précipitent devant elle et la mitraillent en reculant. L’un d’eux, dans l’énervement, tient l’appareil à l’envers et s’envoie le flash dans les yeux!
Filmer dans les rues tient du défi. Seule la présence de gardes armés permet de dégager la foule au moment des prises de vues. Bang! Un coup de crosse sur le vélo d’un gamin le fait déguerpir. Il faut parfois calmer l’ardeur des gardes, qui n’ont pas nos états d’âme quand vient le temps de se faire obéir. Parfois, des policiers s’en mêlent et dispersent la foule à coups de bâton avant de se tourner vers nous pour se faire payer.
Sous les talibans, la police religieuse fouettait allégrement les passants pour les forcer à prier. La soumission devant l’expression brutale de l’autorité est un des comportements les plus surprenants qu’on puisse observer dans ce pays.
La ville est aujourd’hui sillonnée par des camionnettes dans lesquelles s’entassent des soldats et qui arborent le drapeau vert, noir et rouge du nouveau régime. Policiers, gens d’armes et gardes de tout acabit se promènent avec une kalachnikov en bandoulière. On entend tirer presque chaque jour et chaque nuit, et la sécurité est devenue une des premières sources de préoccupation -tout le monde concède que les talibans avaient efficacement réprimé la criminalité.
À la tombée de la nuit, les phares de notre jeep balaient les rues sans éclairage et complètement désertées. À une intersection, un petit feu brûle. Des soldats enturbannés y ont établi un poste de contrôle. Après le couvre-feu de 22 h, les sentinelles, qui sentent le haschisch, arrêtent tous les véhicules. Elles pointent leurs armes et leurs yeux hagards sur les occupants des voitures: ils doivent prononcer le mot de passe.
“Kaboul, murmure d’abord l’homme armé. -Kalachnikov”, répond le chauffeur. Chaque soir, on change de mot de passe: le nom d’une ville afghane pour les sentinelles, celui d’une arme pour les gens qui veulent franchir le poste. Mais cette pratique pittoresque disparaîtra peu après notre arrivée. Le gouvernement et la police ont décrété que la ville était de nouveau “sécuritaire”, et le couvre-feu sera levé.
Comme il n’existe pas de plan de la ville ni de plaques indiquant le nom des rues, nous avons entrepris de les baptiser: rue des Pneus, du Fer, des Oranges, de l’École, avenue des Poutres… Cette dernière tire son appellation de deux immenses poutres de béton armé qui ont résisté à un bombardement et qui, retenues par des tiges de fer, sont restées suspendues dans le vide, à l’horizontale, au-dessus d’un passage piétonnier encore utilisé…
Dans toute la ville, seuls une demi-douzaine de bâtiments ont été ciblés et détruits par les bombes américaines: des résidences d’Al-Qaeda et le siège de la police religieuse des talibans. Les maisons voisines sont à peu près intactes. La précision des bombardements sert bien l’image des Américains. “Les gens voient la différence avec les Soviétiques, qui, dans les années 1980, bombardaient les villes indistinctement, dit Hasif Kakar, un interprète pachtoune. Ils comprennent que la population n’était pas la cible.”
En périphérie de Kandahar, on peut voir les ruines du complexe résidentiel du mollah Mohammed Omar, chef suprême des talibans. Plusieurs grands bâtiments s’y élevaient, pouvant loger des dizaines de personnes. Seule la mosquée a été épargnée par les bombes. Autour, des murs troués par les obus, des montagnes de briques, des escaliers à ciel ouvert et de grandes cours intérieures avec des paysages afghans peints sur les murs. La rumeur veut que ce soit Oussama ben Laden qui ait payé la construction de cet ensemble.
Un gardien -un ex-taliban qui s’est rallié aux forces du nouveau régime- nous montre une chambre qui aurait été celle du mollah. Elle est petite et sans apparat, ce qui confirme l’idée qu’il y ait vécu de manière austère, presque monastique. Omar, dit-on, passait le plus clair de son temps à prier et à méditer dans sa chambre. Il n’y recevait, assis sur son lit, que quelques visiteurs triés sur le volet, et gardait dans une caisse, sous ce même lit, l’argent qui servait à financer la guerre civile!
Au moment d’écrire, on ignore toujours où se trouve Mohammed Omar. En fait, on ne sait même pas s’il est encore en vie. Il aura été le chef d’État le plus mystérieux de la planète. On ne possède aucune bonne photo de lui (il était interdit de le photographier) et son visage n’est pas très connu. Mais les Kandaharis sont nombreux à l’avoir vu. Certains se rappellent une scène survenue ici, en 1996, et qui montre jusqu’où son illumination mystico-politique a pu le mener…
Au centre de Kandahar, le sanctuaire de Kherqa Sharif, au dôme turquoise, abrite la plus précieuse des reliques en Afghanistan: un manteau qui aurait été porté par le prophète Mahomet lui-même! L’accès au sanctuaire est interdit aux infidèles. Le manteau est conservé dans un coffre, sous clef, et n’a presque jamais été montré en public.
En 1996, à l’époque où il tentait de rallier les mollahs du pays à sa révolution islamique, Omar convoqua un grand congrès religieux à Kandahar. Il s’empara du manteau du Prophète et rassembla les religieux sur une grande place de la ville. Là, il monta sur un toit, déploya le manteau, le fit flotter au vent devant la foule subjuguée et le posa sur ses épaules. En bas, on se mit à l’acclamer: “Amir ul Momineen!” -commandeur des croyants, autrement dit, le chef religieux et militaire de tous les musulmans du monde.
“C’était un sacrilège!” s’indigne encore Ahmadullah Popal, un directeur d’école qui assistait à la scène. “Quelqu’un d’impur ne peut pas toucher une telle relique.”
Mais notre garde du corps, Nangialai, comme de nombreux autres talibans, a conservé d’Omar l’image d’un saint. “Je ferais n’importe quoi pour lui. Si on touche à un de ses cheveux, cela conduira à la guerre sainte. Si les Américains le tuent, nous les pourchasserons jusque chez eux!”
Nangialai pense que, de toute façon, la guerre sainte reprendra, tôt ou tard. “La plupart des ex-talibans attendent le début du djihad contre les Américains. Quand la guerre recommencera, ceux qui sont partis à l’étranger et ceux qui se cachent ici vont se retrouver. La moitié des troupes du gouvernement actuel se rallieront à eux.” Nous roulons vers un village où, avons-nous appris, se cache un ex-commandant taliban. Des pics rocheux aux crêtes édentées surgissent au milieu de la plaine poussiéreuse. Aucune verdure à l’horizon. Hormis quelques vallées propices à la culture des fruits, l’Afghanistan est le royaume de la stérilité.
L’ex-commandant habite une masure en terre battue et trouve visiblement surréaliste que des journalistes débarquent chez lui! C’est le mollah Neko. Il commandait 200 talibans contre les forces de l’Alliance du Nord et a été fait prisonnier à la bataille de Kunduz, en novembre dernier. Il s’est évadé, s’est rasé la barbe et a vécu caché pendant deux mois à Mazar-e Charif. Il revient tout juste dans la région et cherche à se faire discret. Ses conseillers, manifestement hostiles à notre présence, lui disent de se taire. “Je n’étais qu’un simple chauffeur pour les talibans”, insiste-t-il. Ce n’est pas lui qui nous en apprendra davantage sur l’avenir des talibans…
En ville, la population semble plutôt heureuse de renouer avec une vie plus libérale. C’est la fête de l’Aïd el-Kébir, qui coïncide avec le pèlerinage à La Mecque. Hier, au coucher du soleil, tous ceux qui avaient une arme ont tiré en l’air pour marquer le début des festivités! Ce matin, dans toutes les maisons où on pouvait se le payer, on a égorgé un mouton, puis on en a distribué la viande.
Pour la première fois depuis des années, des musiciens envahissent les rues (la musique était interdite sous les talibans). Dans notre cour, des gardes du corps montrent à danser à Nangialai, qui n’avait jamais exécuté quelques pas de sa vie!
Est-ce à dire que les talibans commencent à “ramollir”?
Pas vraiment…
“C’est mauvais d’écouter de la musique, pense encore Nangialai, car c’est contraire à la loi islamique. Maintenant, à Kandahar, tout a recommencé: la musique, la télévision, les magnétoscopes et les antennes paraboliques. Personne n’est plus capable d’interdire ces choses. Tout repose sur des décisions personnelles. Aujourd’hui, les gens ont le choix d’aller à la mosquée ou au cinéma.”
Et quand on lui demande si ce n’est pas mieux ainsi, Nangialai n’hésite pas: “Non. C’est mauvais. Il ne faut pas que dans un pays chacun fasse ce qu’il veut.”
La source: Luc Chartrand s’est rendu en Afghanistan pour l’émission Le Point, de Radio-Canada. L’article est publié par L’Actualité, Canada, bimensuel, un publication très apprécié des Québécois (www.lactualite.com).